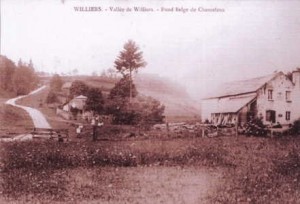WILLIERS 1920
Découverte de la France
Né, selon l’état civil, le 12 ou, selon la geste familiale, le 13 février 1903 à Liège où il passe sa jeunesse, Georges Simenon abandonne ses études à quinze ans et est engagé comme journaliste à la Gazette de Liége malgré son jeune âge. Est-ce dans le cadre de cette activité qu’il entreprend, fin juin 1920, un voyage vers le sud de la Belgique où il découvre la vallée de la Semois tout en poussant une pointe vers le village français de Williers ? Toujours est-il que ce village ardennais inspire une page d’un roman terminé en avril 1921, Jehan Pinaguet, après avoir fait l’objet de deux articles dans la Gazette. Le deuxième commence ainsi :
« Lorsque, de Florenville, en Ardennes Belges, on descend vers le Sud, par un sentier sous bois, encaissé par deux pentes raides que les pins rigides font paraître plus escarpées encore, on débouche en un délicieux vallon dont le centre, formé de quelques verges de prés, est bizarrement découpé par un ruisseau.
D’allures fantasques, ces eaux qui ont des coquetteries de petit-maître font mille grâces aux rayons du soleil dont les prismes mouvants accentuent la délicatesse des teintes du lit de cailloux clairs.
C’est la frontière belgo-française, frontière charmante s’il en est, sans que la borne traditionnellement cubique ou le poteau ceinturé de couleurs vives vienne en rompre le charme sauvage. Du côté de la Belgique, un horizon de forêts ; du côté de la France, un sentier sans ombre, escaladant un coteau couvert de hautes herbes. Au faîte, quelques murs crépis à la chaux, quelques toits d’ardoises irrégulières : le village de Williers ».
Georges Sim, « Willers [sic] – Impressions de voyage », Gazette de Liége, 12 août 1920.
vue aérienne (sur CDR Samsung Pleomax) [droits acquis par moi]
Cliché Christian Marchal, octobre 2005.
L’éperon où est perché Williers. À l’avant-plan de cette vue aérienne actuelle, on découvre le « délicieux vallon » de Chameleux où coule le ruisseau qui sert de frontière, puis la côte empruntée par Simenon pour arriver au village qui a constitué son premier contact connu avec la France.
Les deux scieries de Chameleux, les « eaux qui ont des coquetteries de petit-maître », la « borne traditionnellement cubique » marquant la frontière et le « sentier sans ombre » qui permet d’accéder à Williers. La suite de l’article fait l’éloge du mode de vie des villageois parmi lesquels on ne rencontre « ni riche, ni pauvre, ni propriétaire, ni locataire » et « qui ne constituent en somme qu’une famille unique » (ibid.). Le premier article, daté du 30 juin, ne soutenait-il pas déjà que les habitants de Williers « réalisent à la perfection l’égalité des hommes » ? Jehan Pinaguet, deuxième roman écrit par Simenon, après Au Pont des Arches, répète et amplifie cette idée puisque le village y est manifestement transfiguré et magnifié. Jehan est un jeune homme qui trouve son mentor en la personne d’un abbé Chaumont ; celui-ci lui enseigne en quoi consiste le bonheur et lui tient ce discours, sans toutefois nommer Williers le lieu où il situe son utopie édénique :
« Il me souvient d’un court voyage que je fis l’an dernier dans les Ardennes françaises. Loin des villes et des gros bourgs, loin des châteaux et des grandes routes, des gares et des télégraphes, je rencontrai là, perché sur une colline boisée, le plus coquet village que quiconque ne vit. Figurez-vous, éclairé par un soleil d’août et par le resplendissement de toute la verdure, le spectacle d’une cinquantaine de maisons, toutes également basses, groupant leurs murs éclatants de blancheur et leurs toits pointus autour d’une église, pas beaucoup plus haute qu’elles, dont le clocheton luisait comme une grande aiguille piquée sur la pelote bleue du ciel. Devant les maisons, des poules grouillaient dans le fumier chatoyant de tons dorés et roux. De la volaille partout, sur les chemins et dans les venelles, sur les haies et dans les cuisines ouvertes, caquetant, picorant, remuant des plumes de toutes couleurs. Dans les champs, qui avaient peu à peu rongé la forêt, des femmes de tout âge travaillaient sous leurs grands chapeaux de paille, remuaient la pelle et la charrue, entassaient le foin et fauchaient les moissons. Ah ! quel beau village que celui-là, où vivaient deux cents âmes simples, deux cents paysans, ni riches ni pauvres, possédant chacun une bicoque blanche, un bout de champ, une vache et quelques poules ! Quel beau village que celui-là, où chacun travaillait, où les femmes allaient aux champs, soignaient les bêtes, cuisaient les pains, tandis que les mâles peinaient dans les scieries qui émaillaient les bois environnants.
Ni riches ni pauvres, ai-je dit, et partant pas de haines, pas de querelles. Tous trimaient six jours sur sept, et le dimanche, tandis que les hommes jouaient aux boules, en buvant du marc, les femmes bavardaient, assises sur la place publique ou dans quelque champ voisin. Quelles heureuses gens que ceux-là, qui vivent en communion avec l’âpre terre et le ciel qui la vivifie ! Quels braves gens que ceux qui ne se soucient pas d’amasser, mais de manger et de boire tout leur saoul, en respirant l’odeur des champs et des bois ! »
Georges Sim, Jehan Pinaguet, dans Jehan Pinaguet. Au Pont des Arches. Les Ridicules, Paris, Presses de la Cité, 1991, pp. 90-91
Deux aspects anciens du village dont Simenon a chanté les louanges et qui semble l’avoir fasciné dans sa jeunesse. Témoignage sociologique sur la vie d’une localité minuscule au début du XXe siècle, exposé d’un idéal rousseauiste de vie simple et rustique, réelle attirance pour la France ou simple exercice de style de la part d’un jeune auteur de dix-huit ans ?